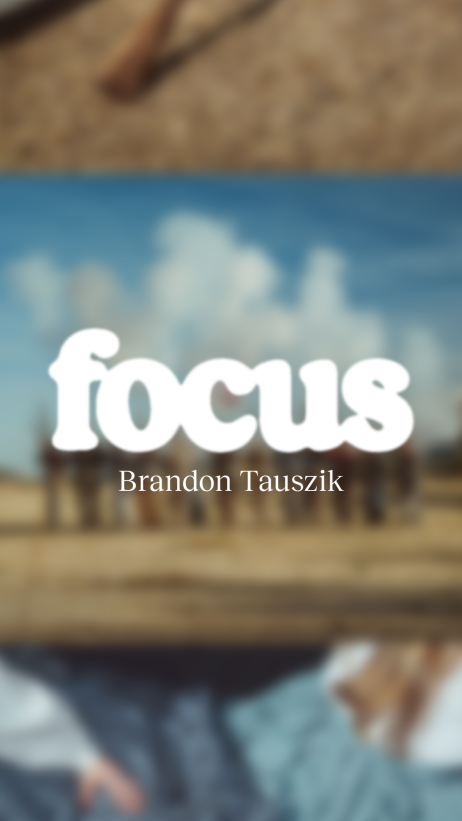À Rome, dès le 3e siècle avant Jésus-Christ, les luttes à mort des gladiateurs, organisées par les empereurs, rassemblent des foules en délire au Colisée. Deux mille ans plus tard, Buffalo Bill rejoue les temps forts de la bataille de Little Bighorn comme une performance étrange ponctuée de tirs à blanc et de scalps factices. Aujourd’hui, les jeux vidéo nous offrent une immersion au cœur d’un champ de bataille, en plein milieu des embuscades, et les blockbusters donnent la lutte en spectacle à coups d’explosions, de duels et de crashs portés par des montages jouissifs et vertigineux. La guerre ne cesse de captiver. Curiosité historique, goût pour le risque ou la violence, elle fédère, marque les esprits, obsède, notre fascination pour elle refusant de faiblir malgré le passage des années. « En 2015, les champs de Waterloo ont à nouveau résonné des tirs de canons et de mousquets alors que 6000 hommes en costume d’époque commémoraient le bicentenaire de la défaite finale de Napoléon. En Grande-Bretagne, le développement d’une organisation d’extrême droite d’amateurs Waffen-SS a également entraîné l’adoption d’une loi limitant les reconstitutions de combats de la Seconde Guerre mondiale aux uniformes des forces alliées, détaille James T. Campbell, professeur d’histoire et doctorant à l’université de Stanford. Et si les États-Unis abritent également des reconstitueur·ice·s nazi·e·s, c’est la guerre de Sécession qui rassemble la plupart des passionné·es. »
Un phénomène qui grandit dès 1913, lorsque plus de 50000 vétérans se lancent dans la reconstitution de la bataille de Gettysburg (1863), en Pennsylvanie. Sur place, durant la reproduction de la charge de Pickett, les deux camps cessent de se menacer avec des armes pour se tendre la main. Un geste symbolique synonyme de réconciliation entre les armées, interrogeant pourtant, en contrepoint, les conséquences d’un tel acte pour la population afro-américaine. En 2011, environ 30 000 personnes participaient aux divers événements organisés au cœur du pays – contre environ 50000 dix ans plus tôt. Un déclin ralenti par la présidence de Donald Trump et la croissance du suprémacisme blanc – puisque le mouvement affecte les regroupements, instaurant une hostilité latente. Une réalité que le photographe Brandon Tauszik qualifie de « particulièrement troublante ».
Ce dernier, également réalisateur, place les enjeux sociopolitiques au cœur de son travail. Entre improvisation (lorsqu’il shoote sur le terrain) et planification (durant la phase de sélection de ses images et la conception de sa narration visuelle), il compose des récits documentaires nourris par des recherches historiques et des questionnements humanistes. C’est en apprenant que des reconstitutions de la guerre de Sécession avaient lieu en Californie – alors qu’aucune bataille ne s’est véritablement déroulée sur place – que l’auteur s’est immergé dans cet étrange univers. « L’État est connu pour être plutôt progressiste. Alors, bien sûr, lorsque j’ai vu une publicité annonçant cet événement, j’ai décidé de m’y rendre. J’étais alors attiré par les incohérences politiques et visuelles qui découlent habituellement de ces endroits atypiques », confie-t-il.




Drapeaux, munitions et fusils, uniformes et robes d’époque, feux de camp, tentes en toile, matelas de paille… Sur place, il découvre la minutie des décors et le dévouement des participant·e·s, qui se divisent en deux catégories. Les « Farbs » ne participent qu’occasionnellement aux reconstitutions. Au contraire, pour les « Progressives », toute expérience doit se vivre pleinement. « Ils deviennent vraiment leurs personnages, recherchent le moindre détail sur les soldats qu’ils jouent, adoptent leurs habits, leurs expressions, leur diction, et même leur régime alimentaire. Ils mangent des haricots dans des boîtes de conserve et dorment sous de fines couvertures à même le sol. C’est une manière pour eux de rendre hommage au conflit américain qui a fait le plus de victimes », commente James T. Campbell. Parmi ces grands passionnés, très peu de personnes noires. Sur le « champ de bataille » comme au cœur des discussions et des débats questionnant les véritables causes du conflit, les opprimé·e·s demeurent (presque) absent·e·s. On assiste à « la promotion d’une histoire sélective, racontée au sein de cette sous-culture. Les acteur·ice·s brandissent une iconographie confédérée et vantent la cause sudiste d’une manière qui serait considérée inacceptable dans le reste de la société », affirme Brandon Tauszik.
Depuis plusieurs années, des discours révisionnistes fleurissent, interrogeant la place de l’esclavage – son abolition et ses conséquences – au sein du conflit. « L’histoire de la guerre civile a été réécrite de nombreuses fois au fil des années. Une fois le conflit terminé, les historien·ne·s sudistes et les United Daughters of the Confederacy [une association héréditaire de femmes créée en 1894 à Nashville pour commémorer les soldats confédérés, ndlr] ont travaillé main dans la main pour réinterpréter cet événement. C’était une véritable propagande, surnommée la “Cause perdue”, explique le photographe. Elle affirmait que les soldats confédérés étaient vaillants et courageux, qu’ils avaient perdu à cause de diverses injustices, mais également que l’esclavagisme était un fait positif. Enfin, elle révélait que ce n’était pas la raison pour laquelle la guerre avait été déclarée. De nombreux·ses participant·e·s aux reconsti- tutions sont aujourd’hui persuadé·e·s que le conflit n’a rien à voir avec l’esclavage. La Cause perdue a réussi à effacer les Afro-Américain·e·s de l’histoire, alors qu’ils et elles ont évidemment joué un rôle primordial et tragique dans ce conflit.»
Une réalité altérée nourrie notamment par la propagation des monuments en hommage à la guerre érigés dans le sud du pays. « La grande majorité a été construite durant le quart de siècle qui a suivi la fin du conflit. Une période marquée par la ségrégation, la privation du droit de vote des Noirs et l’horreur ritualisée du lynchage. Seule une poignée de ces monuments commémoratifs évoque l’esclavage ou son héritage racial, préférant représenter un simple soldat au sommet d’un piédestal, le fusil à la main », rappelle James T. Campbell. Réalisée sous la présidence de Donald Trump, Pale Blue Dress se fait l’illustration de ces incohérences. Alors que les États-Unis doivent faire face à leurs contradictions, des universi- tés, églises et entreprises décident de lever le voile sur l’Histoire et commandent des études sur leurs liens historiques avec l’esclavage. « Des bâtiments nommés en l’honneur de proprié- taires d’esclaves sont rebaptisés, plusieurs villes américaines – dont La Nouvelle-Orléans, Baltimore et Charlottesville – retirent leurs monuments confédérés », précise James T. Campbell. Comme une réaction viscérale à l’impact de l’extrême droite, qui travaille activement à l’affaiblissement des minorités. « L’esclavage est effacé de l’enseignement de l’histoire du pays dans certains États. Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, a activement participé à la mise en œuvre de cette mesure », déplore le photographe. Une menace lourde, allant de pair avec la possible réélection de Donald Trump en novembre 2024.
Cet article est à retrouver dans son intégralité dans Fisheye #63, disponible ici.