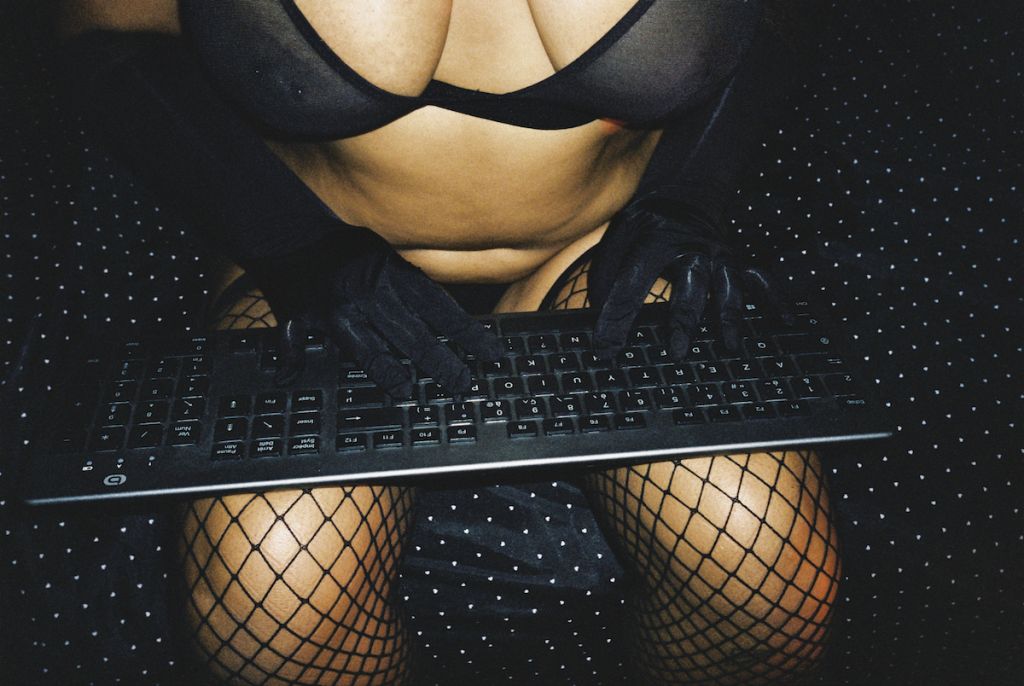C’est dans le cadre de la Grande commande photojournalisme de la BnF qu’Anaïs Kugel a conçu son projet Travailleuses du sexe. S’immisçant avec délicatesse et bienveillance dans l’intimité de ces femmes, elle révèle l’envers de leur profession et entend anoblir leur condition. Dominatrice professionnelle, actrice ou créatrice de contenus pornographiques, camgirl, performeuse et danseuse érotique… En présentant la pluralité et les subtilités du domaine, Anaïs Kugel souhaite déboulonner les a priori et les négligences. Une série destinée à défendre celles que l’on cloisonne à tort dans des cases, en leur donnant une voix par l’image. Entretien.
Fisheye : Qui es-tu ?
Anaïs Kugel : J’ai 34 ans, et je suis photographe et réalisatrice. La photographie est arrivée un peu par hasard dans ma vie, après le lycée lors d’une année passée aux États-Unis, où je m’amusais à faire des autoportraits et des images de mes ami·es. Petit à petit, j’ai commencé à travailler pour des magazines, comme Causette, pour des marques de mode ou encore dans la pub. Cela fait un an que j’ai entamé ce projet sur les travailleuses du sexe.
Les notions de féminin et du corps sont omniprésents dans ton travail. D’où proviennent-elles ?
Je suis retombée récemment sur des images que j’avais faites d’une amie à moi lorsque nous étions adolescentes. Déjà, je l’avais mise en scène nue dans des roses et des draps de satin. J’ai réalisé que les thématiques du corps et de la réappropriation de la sexualité avaient toujours été présentes dans mon travail, mais que je ne savais pas vraiment comment les nommer. Et puis quant aux femmes, je les ai toujours trouvées plus intéressantes que les hommes. Ils m’ennuient beaucoup… Je crois également que j’avais des choses à raconter sur ma mère et ma grand-mère. Photographier les femmes a été véritablement thérapeutique au début, avant que ça devienne une activité qui paye mes factures [rires].

Ton projet Travailleuses du sexe s’inscrit dans la continuité de ces questionnements. De quoi nous parle-t-il exactement ?
Tout est parti de la grande commande photographique de la BNF – initiée par le ministère de la Culture – qui avait pour intitulée Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire. Je savais que je voulais faire quelque chose sur les femmes travailleuses du sexe, mais je ne savais pas par où commencer, même si j’avais déjà mis les pieds dans ce milieu grâce à un documentaire réalisé avec Romy Alizée, mais aussi lorsque j’ai été photographe de plateau pour un film porno produit par Erika Lust. C’était un sujet qui m’intéressait, mais qui manquait cruellement de représentation juste. Au départ, la série s’apparentait davantage à un travail journalistique, mais j’ai vite été frustrée, car je retombais systématiquement dans des choses caricaturales. J’ai donc changé mon processus, en discutant d’abord avec les femmes que j’allais rencontrer pour réfléchir ensemble en amont à ce qu’on souhaitait raconter et la manière de le faire. C’est devenu un mélange de reportages, de mises en scène et de témoignages.

C’est très rare de trouver des projets commandés par le ministère de la Culture française sur le travail sexuel, quand on sait combien ce sujet est tabou au sein du pays…
Je suis la première étonnée. Puisqu’en effet, notre gouvernement essaie plutôt d’abolir le travail du sexe ou en tout cas ne donne aucun cadre sécurisant à tout cela. J’ai été stupéfaite que ma série passe, d’autant plus que je me suis octroyé beaucoup de libertés. Notamment sur des photographies réalisées durant les manifestations, où l’on peut voir écrit sur certaines pancartes « Moins de Darmanin, plus de tapin ». C’était une manière pour moi de continuer à revendiquer avec conviction les droits de ses femmes.
Qu’elle était ta perception des travailleuses du sexe avant d’initier ce projet ?
J’ai beaucoup lu sur le sujet, écouté des podcasts, vu des documentaires… Ma vision était assez claire, mais je m’en suis rendue compte, surtout lorsque j’en ai parlé autour de moi – aussi bien avec mes ami·es que je pensais ouvert·es d’esprit, éveillé·es, éduqué·es – que les personnes n’avaient aucune idée de ce que signifiait réellement être une travailleuse du sexe, avec toutes ces subtilités et divergences. La majorité des personnes interrogées avait des idées préconçues et des jugements très forts sur cette profession. À mesure que ma série prenait forme, j’ai réellement pris plaisir à représenter les choses autrement, à partager toutes ces discussions intimes, à enfin décaler le regard.
Comment as-tu rencontré toutes ces femmes ? T’es-tu confrontée à des refus ?
Ça n’a pas été simple, parce que c’est un milieu qui se protège beaucoup, qui est très solidaire. C’est seulement lorsque j’ai commencé à gagner la confiance d’une première personne, que les autres femmes ont été rassurées. Je me suis beaucoup servi des contacts du Syndicat du travail sexuel (STRASS). Je m’adressais directement à elleux, pour qu’iels relayent ensuite ma demande. J’ai passé de nombreuses heures, car ça marchait beaucoup moins bien que sur les réseaux sociaux. Une fois rentrée en contact, on se rencontrait pour discuter, pour voir comment le feeling passait. Certaines femmes avaient un droit de regard sur mes images. Voir ce que je faisais leur a permis de mieux comprendre ma démarche, et leur a offert une voix pour relayer la leur. Elles m’ont remerciée de pouvoir enfin leur donner la parole en images. Je relate notamment ça dans le journal de bord qui accompagne ma série. J’ai créé des liens d’amitié avec beaucoup d’entre-elles. Dans l’ensemble, c’était plutôt positif et joyeux.



Comment as-tu construit ta série ?
Je discutais d’abord par téléphone avec les femmes que je voulais photographier. Puis, la plupart du temps je me rendais sur leur lieu de travail lorsqu’elles étaient seules, ou alors accompagnées par leur clientèle. D’autres fois, les rendez-vous avaient lieu dans des endroits complètement neutres. Dans le cas de Misungui Bordelle – une dominatrice professionnelle, éducatrice sexuelle et actrice de porno féministe –, je me suis rendue dans son appartement pour assister à une séance de shibari (bondage japonais, ndlr). Avant que la séance ne démarre, nous avons discuté pour savoir comment je pouvais me placer pour ne pas gêner, en utilisant le flash ou non, en la photographiant différemment… Tout en discutant de ce que l’on voulait mettre en lumière. Cela a été assez similaire pour Le Sweet Paradise, un bar à fantasmes et de spectacles érotiques. J’ai assisté au spectacle et ai capturé des images aux côtés de spectateurices. De façon plus générale, ma série s’est construite sur la volonté de représenter la grande diversité des travailleuses du sexe. Puisque c’est là tout le problème, les personnes ne savent pas faire la différence – iels pensent que le travail du sexe ne se définit que par le sexe tarifé.

La notion d’argent est au cœur de ta série. Comment s’articule-t-elle ?
Le nom de la commande était relié en lui-même à cette thématique. J’ai interrogé chaque femme sur le sujet, afin de savoir comment elles ont pu tenir bon durant le COVID sans aucun filet de sécurité. Par exemple, lorsque j’ai rencontré Samantha Dubois, qui travaillait au bois de Boulogne, et qui, depuis la loi de 2016 (loi abrogeant le délit de racolage et prévoyant la pénalisation des clients de personnes prostituées, ndlr), avait déjà eu plus de mal à avoir des clients, elle m’a raconté combien il a été difficile de gagner de l’argent. Pour toutes les travailleuses du sexe, l’argent qu’elles gagnent n’est en aucun cas de l’argent facile. C’est un métier qui en cache plein d’autres : secretariat, marketing, ménage, préparation physique…

J’ai la sensation que tu poses un regard plutôt apaisé sur la situation. Tu ne montres pas, ou peu, ce qui peut être nocif pour ces femmes ?
J’avais avant tout envie de montrer leur force et leur fierté, tout simplement parce qu’elles en possèdent beaucoup. Je souhaitais les représenter comme je les avais rencontrées, et non comme les personnes fermées d’esprits peuvent les imaginer. Personnellement, j’ai trouvé ces espaces très sains, justement parce que tout le monde sait pourquoi iel est là. Les règles sont claires. Je trouve le sexe gratuit plus malsain et plus flou, je sais qu’avec des applications de rencontres comme Tinder, nombreuses sont les femmes qui ont l’impression de faire un travail du sexe non rémunéré. Il y a des fantasmes, des choses qu’on ne peut pas réaliser seul·es sans l’aide d’un·e professionnel·le. C’est un vrai métier qui nécessite une certaine maîtrise. Heureusement que ces lieux existent, qu’il y a des endroits décomplexés pour vivre les choses, tant que tout le monde est consentant·e. Pour la plupart des femmes, il y a une dimension politique : être travailleuse du sexe, c’est ne pas avoir de patron, choisir ses horaires, son lieu de travail. Il y a une dimension de liberté et d’autogestion. J’ai également ressenti le travail du sexe comme un travail du care… Bien que cela reste souvent centré autour du « cul », il y a tellement d’autres choses derrière. Pour les séances de domination, ou même dans les représentations pornographiques, il y a constamment une dimension de tendresse.
Évidemment, nous avons parlé de la violence. Néanmoins, je ne l’ai pas tellement représentée parce que dans la réalité c’est très rare de tomber sur des clients violents – je dis clients, car pour la majorité ce sont des hommes –. Ça arrive malheureusement, mais des moyens de protection sont mis en place. Afin de contacter une escorte, par exemple, il faut aller sur son site, se présenter, répondre à trois questions et envoyer sa demande. Elles m’expliquaient que lorsque quelqu’un n’est pas capable de faire cette simple démarche, c’est qu’il aura certainement plus de difficulté à entendre un non. Puis il y a l’application Jasmine qui leur permet de signaler les clients selon trois codes couleurs. Quand elles ont un nouveau client, elles peuvent rentrer le numéro et elles voient s’il a été signalé. Et entre elles, elles se passent le mot. Anaïs De Lenclos, escorte et porte-parole du STRASS, me disait cependant qu’elles acceptent parfois des clients qu’elles auraient refusés avant, car la loi 2016, qui pénalise les clients, les a précarisés et les a poussés à prendre plus de risques. Cela met aussi les clients en situation de force, et certains ne se gênent pas pour négocier les tarifs ou les pratiques. Finalement, selon moi la violence est plus symbolique, elle provient davantage de la société, ou alors du gouvernement ; notamment vis-à-vis des lois mises en place et des jugements constants.

« Heureusement que ces lieux existent, qu’il y a des endroits décomplexés pour vivre les choses, tant que tout le monde est consentant·e. J’ai également ressenti le travail du sexe comme un travail du care… »
Tes photographies sont de manière générale à ras des draps, à ras des corps…
Je trouve qu’il y a trop de lits dans ma série d’ailleurs [rires]… Mais j’y tiens, ce sont les lieux où nous nous retrouvions, où elles travaillaient. Il n’y avait souvent qu’un seul lit parce qu’il s’agissait de leur studio ou d’une chambre d’hôtel. Sur la fin, j’ai voulu les sortir du lit pour éviter la redondance. Et puis je n’avais pas envie qu’elles soient passives, je tenais à ce qu’elles se tiennent debout.
Il y a-t-il une rencontre qui t’a marquée ?
Je dirais Mia. C’est la première qui m’a dit oui. Je l’ai suivie sur plusieurs mois, c’était vraiment précieux de l’avoir dès le début parce qu’elle avait totalement confiance en moi, j’avais carte blanche. Mais il y a surtout la lecture de TDS : Témoignages de travailleuses et travailleurs du sexe de Tan Polyvalence, qui m’a énormément marquée. Toutes les personnes qui ne savent pas, ont des a priori, et ne comprennent pas ce que le travail du sexe signifie, devraient le lire !


Depuis cette série, ton regard a-t-il changé sur ce type de profession ?
Lorsque j’ai partagé cette série sur mes réseaux sociaux, il y a eu une vague de haine. Je me suis pris des critiques affreuses de féministes abolitionnistes, m’insultant de proxénète, disant que je faisais l’apologie de la prostitution. Selon moi, ces personnes, et beaucoup de féministes confondent le travail du sexe et la prostitution forcée. Dans ce projet, je parle d’un métier choisi, qui est mutuellement consentant. En continuant de discriminer, d’ostraciser ces femmes, nous les mettons en danger : elles sont contraintes de travailler dans l’insécurité.
Toutes ces accusations m’ont déstabilisée dans la conception de ma pratique. Puisqu’au début, j’ai pensé que je racontais mal ces histoires, ou alors que mon propos n’était pas clair. Finalement, je pense que cela a renforcé l’envie de me battre. Je suis encore plus convaincue qu’il faut les défendre. Je trouve l’hypocrisie de la société insupportable. Maintenant que la commande officielle est terminée, j’aimerais continuer à faire vivre le projet, en allant dans d’autres pays d’Europe afin d’y documenter les différences, pour avoir une vision plus globale de cet univers.