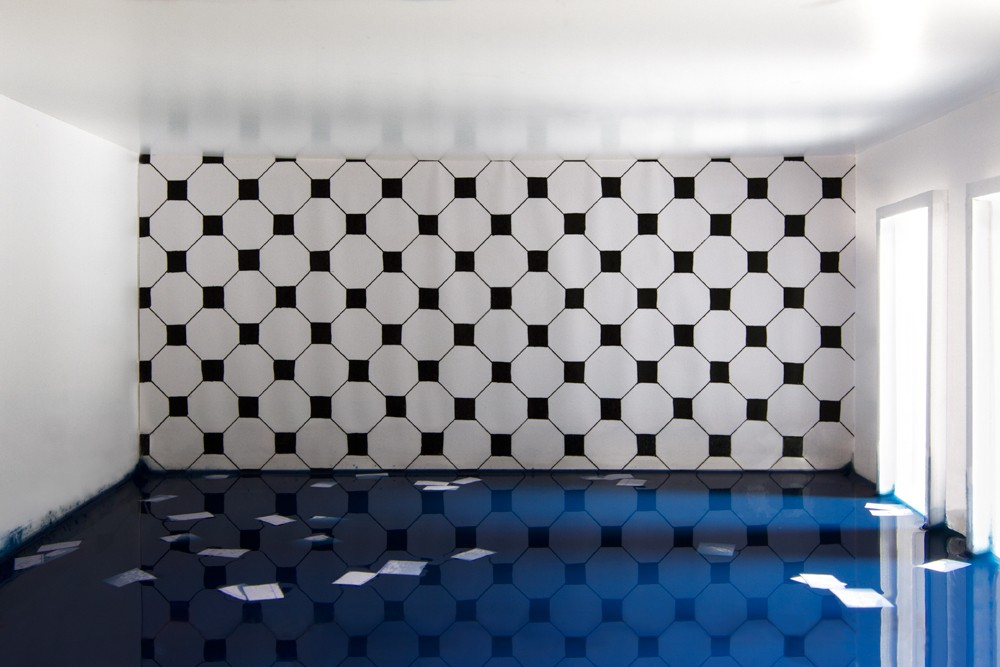Fisheye : Comment vous êtes vous rencontrés ?
Alexis Vettoretti : A l’école ! Nous étions tous de la même promo à l’École de Photographie de Game Design de Toulouse (ETPA). Du coup on se connaît depuis la première année. On a appris la photographie ensemble et nous nous sommes construits ensemble.
Alexandra Davy : Et après nos trois ans à l’ETPA, on a tous bougé sur Paris. C’était en septembre 2013.
Nicolas Rivals : Juste après le lancement de Fisheye [rires] !
Une fois votre diplôme en poche, vous aviez déjà décidé de monter un projet ?
N.R. : Non, ça ne s’est pas fait tout de suite. La réflexion a eu lieu une fois que nous nous sommes installés dans la capitale. Progressivement, on s’est mis en tête qu’il fallait avancer à plusieurs.
A.V. : En fait c’était une logique qui s’est inscrite dans la continuité de l’école. On se voyait tout le temps à l’école, on a travaillé ensemble à l’école, on regardait toujours le travail des uns et des autres… Donc il y a une relation de confiance qui s’est construite entre nous. Sur Paris, il a fallu réfléchir aux personnes susceptibles de pouvoir nous aider à produire : et en fait, c’était le groupe.
Margaux Birch : Nous nous sommes regroupés, sans avoir tout de suite conscience de former un collectif.
A.D. : Oui c’est ça, on avait besoin d’une dynamique pour travailler.
Est-ce que la création de ce collectif n’a pas été un moyen de vous rassurer, de vous poser dans un cadre plus formel que la bande pote?
M.B. : Ce n’est pas plus formel je trouve. En tout cas ça ne l’était pas au début : rien n’était vraiment fixé, on se voyait pour parler de nos images, pour avancer et nourrir notre travail. Ce n’était pas vraiment pour se rassurer…
N.R. : Déjà à l’école, nous étions habitués à parler de nos travaux. En troisième année, nous étions même très autonomes donc nous avions besoin du retour de chacun pour avoir du recul et un regard critique sur nos images.

Comment la décision a été prise de former un collectif ?
N.R. : Par un « oui » unanime déjà…
A.V. : Oui, il n’y a eu aucune hésitation !
M.B. : Mais je souviens qu’au tout début, nous nous sommes dit que si on arrivait à garder contact, à se voir régulièrement, on se lancerait !
N.R. : C’est vrai. Nous n’avions pas la naïveté de croire qu’on allait fonder quelque chose d’extraordinaire, pour se décourager quelques mois plus tard. Alors nous avons déterminé des objectifs à notre hauteur, afin de pouvoir avancer petit à petit et progresser.
A.V. : Il n’y a pas eu de vision à long terme dés le début. Pour l’instant, nous n’avons pas de structure, ni d’identité juridique ou associative. Nous sommes un collectif parce que nous sommes ensemble. Donc nous n’avons pas besoin de nous structurer. Parce que nous continuons de nous construire ensemble.
« Si c’était plus simple, peut-être que le collectif n’existerait pas »
Quels collectifs sont vos références ?
N.R. : Bien sûr ! Il y a Temps Machine, un collectif toulousain. Myop, puisqu’un de nos professeurs en fait partie. Tendance Floue aussi. Nous avions de quoi nous inspirer. Mais l’idée de créer notre propre collectif a vraiment émergé à Paris, à cause de toutes les contraintes professionnelles qu’on y rencontre.
A.V. : Oui si c’était plus simple, peut-être que le collectif n’existerait pas. En tout cas on a tout de suite saisi les avantages à travailler ensemble et pas séparément. La photographie passe par le partage, ce ne doit pas être un truc d’égoïste. C’est aussi parce que nous partageons cette vision du métier qu’il nous a semblé évident de se réunir.
A.D. : Quand on arrive à Paris, on fait face à pleins de difficultés : le boulot n’est pas simple à trouver, on se noie dans les démarches, on envoie des mails qui ne trouvent pas de réponses…

Surtout quand on n’est pas connu…
N.R. : C’est certain ! On sort d’école, on est jeunes et sans réseau…
A.D. : C’est vraiment la galère. Mais enfin, on s’est tous débrouillés pour gagner un salaire avec un boulot « alimentaire ».
Comment fonctionne le collectif ? Quels sont vos objectifs à travers lui ?
N.R. : Ils sont progressifs. Au tout début, on se retrouvait pour se montrer nos travaux. Ensuite, l’idée d’une exposition commune a commencé à émerger. On est parvenus à la réaliser. Du coup, ça nous à motivés à en monter une deuxième… Voilà ! On avance étape par étape.
A.D. : Et puis on a aussi un rendez-vous hebdomadaire depuis quelque mois, ce qui nous motive vraiment. Au tout début c’était un peu sporadique, c’était comme on pouvait. Aujourd’hui, nous avons trouvé notre créneau, chaque mardi à 19 heures 30. Et donc notre rythme.
Quelle est votre situation économique ?
N.R. : Pour l’instant, on s’autofinance à 100 %. On recherche pas mal d’appels à projet, des lieux d’expositions…
A.V. : Pour ce qui est des expos, il y a toujours des acteurs extérieurs prêts à apporter une participation financière. Notre école par exemple. C’est une forme de mécénat qui nous booste pas mal, puisque ça montre que l’on ne fait pas ça pour rien.
Pensez-vous que vous auriez pu exposer sans le collectif ?
A.V. : Plus difficilement, c’est clair. Le collectif apporte un poids, une crédibilité artistique. En terme de communication aussi : on multiplie par huit notre réseau. Surtout le collectif montre que l’on existe. Or ce dont ont besoin les jeunes photographes, c’est d’être pris au sérieux et d’être reconnus comme tels.