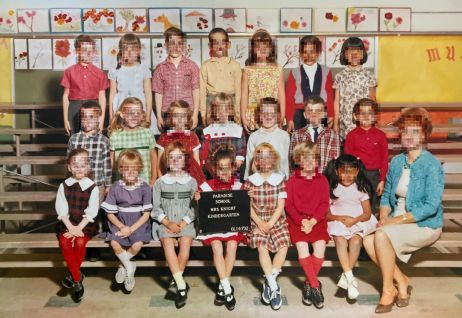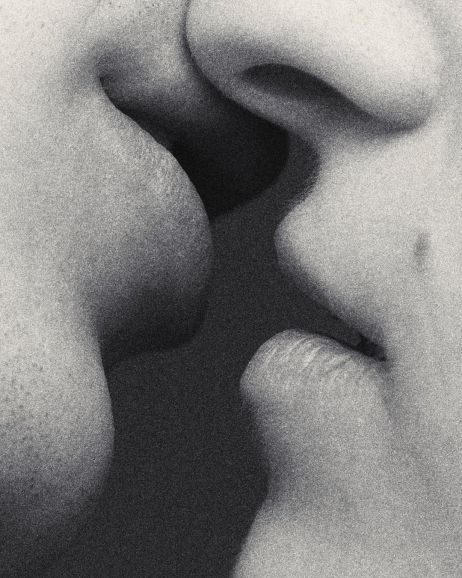Dans une série sobrement intitulée Berlin, Diane Meyer associe une fois de plus la photographie au point de croix. Ici, elle utilise cette technique de broderie pour faire apparaître, à la manière d’un fantôme, le mur qui scindait la ville. S’il fut détruit en novembre 1989, les traces de son existence demeurent perceptibles.
Fisheye : Tu es à l’origine de Berlin. En quoi cette série consiste-t-elle ?
Diane Meyer : Berlin porte sur les strates de l’histoire et de la mémoire dans un lieu particulier. La série est constituée de 43 tirages qui suivent l’intégralité du tracé du mur. Certaines parties des photographies ont été masquées par du point de croix, ajouté à la main, à même le support. Le motif créé emprunte au langage visuel de l’imagerie numérique et offre une vue pixelisée de ce qui se trouve derrière. Ainsi, il révèle et dissimule à la fois le mur et apparaît comme une trace translucide ou un fantôme de quelque chose qui n’existe plus dans le paysage, mais qui pèse encore sur l’histoire et la mémoire. Cette manière dont la photographie transforme notre compréhension du passé m’intéresse vivement.
« J’ai été étonnée de constater comme il divisait les rues, aujourd’hui pleines de vie, de manière aussi abrupte. Je suis alors partie à la recherche d’indices subtils de sa présence, qui subsistaient dans le paysage […]. »
Quel a été le point de départ de cette série ?
J’ai effectué une résidence artistique à Berlin et, bien que je n’aie pas eu l’intention de faire un projet sur le mur, j’ai été immédiatement attirée par le paysage changeant de la ville. L’étude des qualités physiques, sociales et psychologiques qui caractérisent un lieu a souvent été au cœur de mon travail. J’étais donc impatiente d’explorer un nouvel endroit. J’avais 13 ans lorsque le mur est tombé et je me souviens très bien de l’avoir vu à la télévision à l’époque. Je savais qu’il divisait l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest et que sa chute représentait la fin de la guerre froide, mais je n’ai pleinement réalisé l’ampleur de la situation qu’après avoir passé plusieurs mois là-bas.
J’ai notamment réalisé à quel point Berlin-Ouest était isolé. Le mur encerclait cette partie de la ville, laquelle était entièrement entourée par l’Allemagne de l’Est. J’ai été étonnée de constater comme il divisait les rues, aujourd’hui pleines de vie, de manière aussi abrupte. Je suis alors partie à la recherche d’indices subtils de sa présence, qui subsistaient dans le paysage : des parcelles d’arbres plus petits que d’autres, des terrains ouverts, de nouvelles constructions, des différences architecturales dans certains quartiers, des lampadaires orientés dans la mauvaise direction… Je voulais suivre toute sa circonférence pour voir comment il séparait non seulement le centre de la ville, mais également les banlieues et les forêts environnantes.


Comment es-tu parvenue à trouver le chemin par lequel passait le mur ?
J’ai retrouvé le tracé de l’ancien mur, qui fait à peu près 160 km de long, à l’aide d’une application nommée, à juste titre, Berlin Wall. Elle a été créée par le Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam et le Bundeszentrale für Politische Bildung and Deutschlandradio. Elle intègre un GPS et indique l’emplacement exact des murs intérieurs et extérieurs. Il existe une piste cyclable qui suit approximativement ce chemin, mais j’ai souvent dû la quitter pour me rapprocher des lieux précis. En voyageant dans les banlieues, constater qu’une grande partie de la séparation avait traversé la nature – les lacs étaient utilisés comme frontières, par exemple – m’a beaucoup marquée. Je n’en revenais pas de voir comment des endroits aussi beaux ont pu être envahis et ruinés pendant un certain temps.



« La broderie, par sa matérialité, est légèrement surélevée par rapport à la surface du tirage. Elle souligne ainsi les limites artificielles créées par le mur et devient littéralement une barrière pour le reste du paysage. »
Plus largement, quel a été ton processus créatif ?
Au départ, de manière globale, je souhaitais surtout réfléchir à la matérialité des clichés en les combinant notamment avec le langage visuel de l’imagerie numérique. En expérimentant le processus, j’ai réalisé que je pouvais faire correspondre les couleurs des compositions et créer un effet de pixélisation. En faisant référence à cette dernière, je voulais établir un lien entre l’idée d’oubli et la corruption des fichiers, d’autant plus qu’une grande partie de ce dont nous nous souvenons découle des photographies.
Dans cette série, je considère que le point de croix et la photographie ont le même poids. La broderie, par sa matérialité, est légèrement surélevée par rapport à la surface du tirage. Elle souligne ainsi les limites artificielles créées par le mur et devient littéralement une barrière pour le reste du paysage. À propos de cette œuvre, la conservatrice Claudia Bohn Spector a écrit que « la couture transperce le tirage tout en cicatrisant et en dissimulant le tissu historique auquel elle fait allusion. Elle offre un contraste poignant avec la brutalité inflexible du mur et nous rappelle l’artifice considérable de la photographie et de l’histoire ». Bien que je n’y aie pas pensé consciemment, j’apprécie cette interprétation de la broderie comme métaphore de la guérison.


Quelle a été la plus grande difficulté à laquelle tu as fait face ici ?
Quand j’ai commencé le projet, je n’ai pas fait de recherches en amont, si ce n’est l’emplacement du mur, donc. Je me suis contentée de suivre le chemin et de photographier intuitivement les endroits qui me semblaient être les plus intéressants. Une fois de retour chez moi, j’ai développé toutes les pellicules et le plus grand défi a été d’éditer les clichés. Au total, j’ai tiré autour de 150 bobines de film moyen format et j’avais des centaines et des centaines d’images à examiner. Je souhaitais montrer un éventail de lieux aussi large que possible. On retrouve ainsi des forêts, des espaces touristiques situés en dehors du centre-ville, comme le pont Gleinicke ou l’église Heilandskirche de Sacrower. En ce qui concerne l’emplacement du mur dans chacune des photographies, j’ai fait des recherches et consulté des livres et des sites web, ainsi que des documents d’archives au musée Wende de Los Angeles.


« J’ai trouvé intéressant de constater que la mémoire collective semble exister différemment selon les générations. L’une se souvient du mur et de tout ce qu’il représentait tandis que l’autre a l’air d’avoir une perspective nostalgique, qui ignore pourtant l’histoire réelle. »
Comme tu le soulignes, même si le mur n’est plus là, nous pouvons encore sentir sa présence aujourd’hui, et ce, à différents niveaux. Peux-tu m’en dire plus à ce sujet ?
À Berlin, j’ai été frappée par l’omniprésence du mur dans le centre-ville. Il fait partie de l’expérience visuelle quotidienne. Cela m’a amenée à penser que, du jour au lendemain, des familles ont été divisées. Leur relation avec la ville elle-même a été modifiée. Ces personnes ont dû changer leurs itinéraires et leurs habitudes, et ce, en particulier à Berlin-Ouest, dont la superficie géographique ne permettait que difficilement de l’éviter, même visuellement. Son fantôme était encore perceptible, car j’étais consciente de sa présence. Au cœur de la ville, il y a plusieurs espaces où des morceaux du mur ou quelques tours de garde ont été intentionnellement laissés en place. Des pavés indiquent notamment l’endroit où ils se trouvaient. Tous ces vestiges servent d’avertissement aux générations futures qui ne doivent pas répéter les erreurs du passé.
Beaucoup de jeunes habitent aujourd’hui à Berlin. Leur expérience de la ville n’est pas la même que celle des personnes plus âgées, qui ont connu cette division. J’ai trouvé intéressant de constater que la mémoire collective semble exister différemment selon les générations. L’une se souvient du mur et de tout ce qu’il représentait tandis que l’autre a l’air d’avoir une perspective nostalgique, qui ignore pourtant l’histoire réelle. Cela se manifeste, entre autres choses, sous la forme de bars à thème ou de magasins d’occasion vendant des vêtements estampillés RDA.

Quelle est ta relation à la mémoire, justement ?
J’ai commencé à penser à cela lorsque j’ai entamé Time Spent that Might Otherwise Be Forgotten, une série de tirages au point de croix toujours en cours. Celle-ci se compose de clichés de famille et de voyage qui créent une sorte d’archive. La manière dont les photographies parviennent à remplacer les souvenirs et les expériences vécues – une idée notamment abordée par Susan Sontag et Roland Barthes – me fascine depuis longtemps. Ce qu’elles racontent diverge souvent de la réalité de façon spectaculaire, mais elles réussissent tout de même à s’imposer comme une autre version de la vie d’une personne, d’une population.