


En Bolivie, dans les rues agitées de La Paz, se cachent d’étranges personnages. Leurs visages cachés par des masques ou des cagoules, ils arpentent le centre-ville à la recherche de chaussures à faire briller. Anonymes, ils se fondent dans le décor de la capitale, font partie intégrante de son histoire. Armé·es de divers accessoires, ils font reluire le cuir, étinceler les baskets, tel·les des superhéro·ïnes étrangement ordinaires. Mais qui sont ces mystérieux·ses bienfaiteurices ?
C’est dans les années 1980, alors que la Bolivie vit un nouveau coup d’État (il y en a eu plus d’une centaine depuis l’indépendance du pays, en 1825) et subit une crise économique qui s’enlise, que des cireur·ses de chaussures font leur apparition à La Paz. Issu·es des tribus amérindiennes installées aux alentours – notamment les Aymaras et les Quechuas – ces travailleur·ses s’installent à El Alto, une ville située dans le prolongement de la capitale, cherchant à fuir la misère de la cam- pagne. Sans formation ni compétence, peu arrivent à trouver de vrais métiers. Iels se tournent vers le lustrage des chaussures de l’élite bolivienne pour gagner leur pain. Aujourd’hui, leur commerce est devenu un véritable phénomène social, emblématique de La Paz. Chaque jour, plus de 3000 lustrabotas – hommes et femmes – foulent le bitume à la recherche de client·es. « Cette tribu urbaine se distingue par le port de masques de ski, afin de ne pas être reconnue par des proches. En les enfilant, les lustrabotas luttent contre la discrimination à laquelle iels sont confrontés. À l’école comme au sein de leur foyer, tout le monde ignore leur véritable métier. Tous les matins, iels quittent leur domicile comme des travailleurs ordinaires et entreposent leurs outils et cirages dans des lieux investis par des associations, où iels déjeunent et se nettoient les mains avant de rentrer chez elleux, à El Alto », raconte Federico Estol. Il affirme : « Le port du masque, c’est leur identité la plus forte. C’est ce qui les rend invisibles, ce qui les unit. C’est cet anonymat collectif qui m’a donné envie de développer ce projet. »
Se considérant comme un « conteur d’histoires inspiré par les communautés ainsi qu’un “artiviste” », le photographe a travaillé pendant quinze ans pour le gouvernement uruguayen en tant que développeur communautaire dans des petites villes, avant de se tourner vers le 8e art. Fervent amateur de la pédagogie de Paulo Freire [pédagogue et philosophe brésilien qui percevait l’éducation comme un outil permettant aux classes dominées d’acquérir des savoirs émancipateurs pour changer leurs conditions de vie], il tâche d’appliquer son idéologie à ses projets. « Je conçois la photo comme un instrument de libération donnant naissance à une nouvelle relation entre les artistes et le groupe d’humains impliqué », précise l’auteur, qui n’hésite pas à endosser le rôle de médiateur, tissant ainsi des liens entre les enjeux sociopolitiques qu’il aborde et le monde des images. « La photographie contemporaine qui dialogue avec des éléments de fiction a tendance à s’éloigner de ces sujets importants. On perd l’occasion de collaborer de manière positive et directe avec les communautés. Ce projet m’a permis de réaliser que la photo amateur a beaucoup de potentiel, et que les projets collaboratifs sont une merveilleuse manière de stimuler sa créativité et d’ouvrir le dialogue aux autres », poursuit-il.




Un soir, alors qu’il dîne en famille, l’un de ses proches mentionne l’existence et les conditions de vie des lustrabotas venu·es d’El Alto. Intrigué, Federico Estol mène l’enquête et découvre l’association qui produit Hormigón Armado, un journal mensuel publié depuis seize ans, dont les ventes permettent aux cireur·ses de chaussures d’obtenir un petit complément de salaire. Une initiative aidant près de 60 familles de travailleur·ses. « Je me suis dit qu’il serait intéressant de collaborer pour créer une édition spéciale abordant le thème de la discrimination. Une édition réalisée grâce à un dispositif participatif et distribuée avec des flyers destinés à sensibiliser les citoyen·nes de La Paz à cette cause. C’était une manière d’aller dans la direction opposée à ce qu’un média aurait pu me demander de faire en couvrant une telle histoire», raconte l’auteur de Héroes del Brillo. Si, au départ, chaque membre de l’association participe à la prise de vue, une nouvelle organisation se met progressivement en place, permettant à Federico Estol de réaliser une véritable série photographique transcendée par une écriture singulière. « C’est finalement moi qui ai réalisé tous les clichés, grâce à leur soutien continu durant trois ans », précise-t-il.
Flashs implacables, brosses à chaussures transformées en armes et boucliers, boîtes à cirage argentées étincelant au soleil, masques mystérieux dissimulant les visages des lustrabotas… Agrémentée de dessins colorés conférant à l’ensemble une dimension fantastique, l’édition spéciale évoque un comic book relatant les aventures de nos super- héros favoris. « Chaque samedi, nous nous réunissions pour discuter du contenu des prochaines éditions. Durant l’une de ces réunions, quelqu’un a apporté un vieux numéro dont la couverture représentait un cireur de chaussures vêtu d’une cape et arborant le logo de Superman sur sa poitrine », se souvient l’auteur. Un hommage qui produit un vif enthousiasme.
Quelques jours plus tard, des illustrateurices bolivien·nes rejoignent l’équipe et conçoivent un roman graphique. Un projet porté par une direction artistique claire : présenter les shoeshiners comme les protagonistes d’un récit d’aventures. « Nous avons ensuite organisé un atelier pour lister les parallèles entre les travailleur·ses et les super- héros : porter un déguisement (le masque de ski) pour cacher leur identité, mener une double vie et dissimuler leur emploi à leurs proches, être persécuté·es par les “ennemis” (la police), utiliser des outils spéciaux (les brosses, les tissus, les cirages), avoir une cachette (les associations où ils stockent leurs vêtements et leurs accessoires) et enfin, être au service des autres », énumère Federico Estol. Un concept dont l’originalité séduit à l’unanimité : en trois mois, 6 000 copies sont vendues à La Paz, tandis qu’une maison d’édition uruguayenne, El Ministerio Ediciones, distribue 1 000 exemplaires dans des festivals et autres événements photo. Un succès important pour la communauté, qui souffre de préjugés. « Les lustrabotas ont mauvaise réputation. On les considère comme des alcooliques, des addicts, des voleur·ses… Beaucoup sont ostracisé·es. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils couvrent leur visage, préférant l’anonymat à la mise à l’écart. En vérité, 90 % d’entre eux sont des personnes normales, âgées de 6 à 80 ans, cherchant simplement un moyen de gagner de l’argent pour leur famille », confie le photographe.




Plus qu’une simple BD insolite dressant le portrait d’un groupe de personnes dont on ne connaît presque rien, Héroes del Brillo s’impose comme un manifeste singulier, un appel à l’engagement et à l’action par le pouvoir de l’imagination. « La tradition documentaire n’a plus le même impact qu’avant, parce que le public a évolué. Aujourd’hui, il regarde Netflix et ne fait plus confiance aux informations. Il est plus habitué aux fictions qu’à la réalité. Je pense donc qu’avoir recours au fantastique pour aborder de réels problèmes est un acte censé dans ce monde polarisé », affirme Federico Estol. En représentant ces travailleur·ses comme les bienfaiteur·ices d’une ville, la traversant à la recherche de client·es à « sauver », l’artiste inverse les rôles et propose aux spectateur·ices de poser un nouveau regard sur celles et ceux que l’on préfère ignorer. Une action louable qu’il poursuit en partageant le fruit de cette collaboration avec ses contacts du milieu de l’art. « Je pense que nous nous devons de générer une aide directe, d’offrir quelque chose de concret, pas une simple publication. Parce qu’au final, les lecteurices de magazines restent confortablement assis·es dans leur canapé et ne vont pas entamer d’actions pour aider ces gens – ils vont juste consommer leur histoire », rappelle-t-il.
Depuis sa publication, l’édition spéciale du journal a remporté plusieurs prix. Elle a été publiée et exposée dans le monde entier, et a rapporté 10 000 dollars à l’association et aux lustrabotas. Une véritable performance offrant aux cireur·ses de chaussures une aide financière et une reconnaissance inespérées. « Au total, 12 000 livres, 8 000 calendriers et 500 cartes postales ont été imprimés, révélant au passage une nouvelle photographie sociale désireuse de fournir une aide concrète aux groupes vulnérables d’Amérique latine », conclut le photographe.


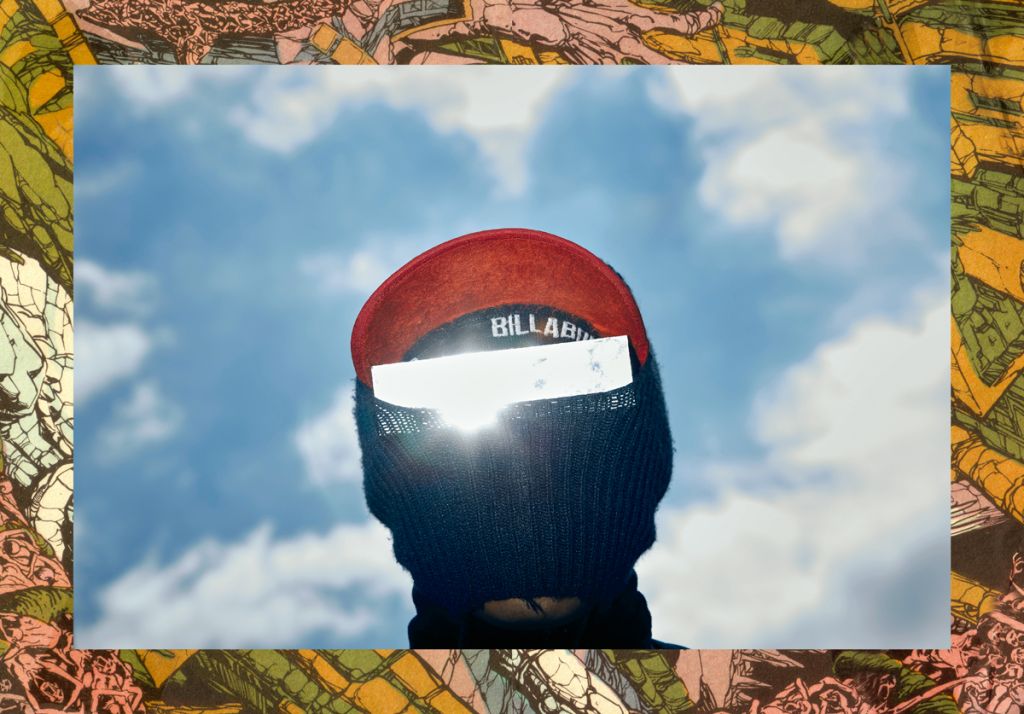




30$






