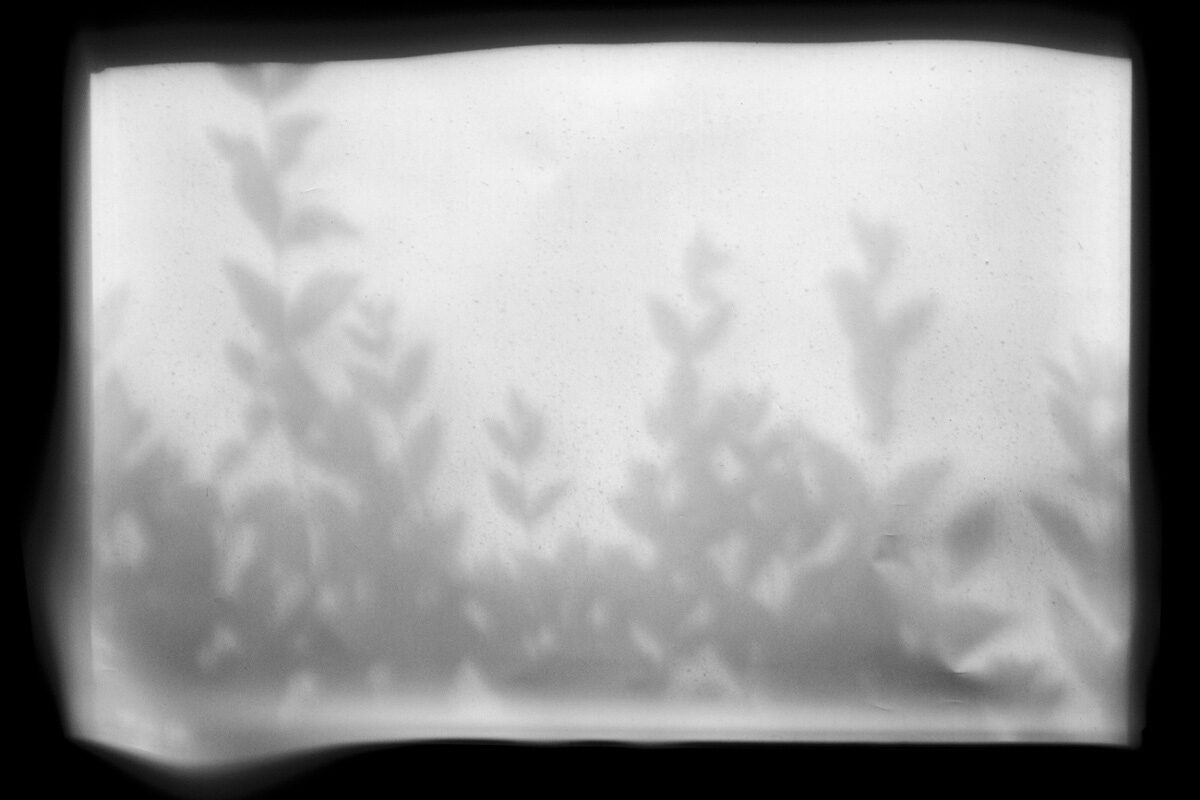Livre petit format mêlant une enquête énigmatique et des images, Reliqua desiderantur est une déambulation au cœur des limbes de l’esprit de son auteur, Benoît Méjean. Dans un noir et blanc flou, mélancolique, l’artiste exprime pleinement son besoin de créer, ses obsessions comme ses questionnements, ses échecs et ses instants de grâce. Un essai sensible rendant hommage à sa passion pour la photographie, née brusquement, d’un incident tragique : le suicide de sa sœur aînée. Rencontre avec un poète croisant les médiums pour mieux communiquer.
Fisheye : Qui es-tu, Benoît Méjean ?
Benoît Méjean : Pour parodier Jane B. de Gainsbourg, et rester dans le domaine de l’enquête :
« Signalement yeux bleus (plutôt verts-gris-noisettes suivant la saison)
Cheveux poivre et sel
Benoît M.
Européen d’origine française
De sexe masculin.
Âge : entre 49 et 50 ans
Apprend la photographie
Domicilié là où s’évapore son esprit ».
Plus prosaïquement, j’habite à Villejuif, j’ai deux enfants, je suis comédien voix – pour des entreprises, musées, documentaires – depuis une douzaine d’années. Avant, je naviguais solitairement entre écriture, composition et interprétation de chansons, poèmes, romans et nouvelles inachevés, bande-sons un peu étranges, spoken words improvisés…
Tu revêts de multiples casquettes. Qu’est-ce qui t’a guidé vers la photographie ?
Et qu’est-ce que qui m’aurait retenu d’en faire ? Enfant, je me souviens avoir réalisé avec une grande application quelques images avec un jetable automatique et argentique. Puis, lors d’un déménagement – j’avais douze ans – pour garder en moi ce lieu qui allait être perdu, j’ai capturé les détails de ma chambre.
Plus tard, quand sont venus l’écriture, le chant et les voyages, tout est passé par le son, en ayant même une aversion ou un dédain pour l’image : je m’interdisais d’en faire. Il y a une dizaine d’années, l’envie de photographier « pour de vrai » a commencé à sérieusement se faire sentir, mais la question de la légitimité me retenait. Ce n’était, techniquement, croyais-je, pas fait pour moi, trop complexe. Il y avait également quelque chose de plus « obscur » que je n’ai compris qu’après : ma sœur aînée était amoureuse d’un homme qui publiait chaque jour ou presque sur un blog un poème et une photo. Je ne pouvais donc pas faire la même chose.
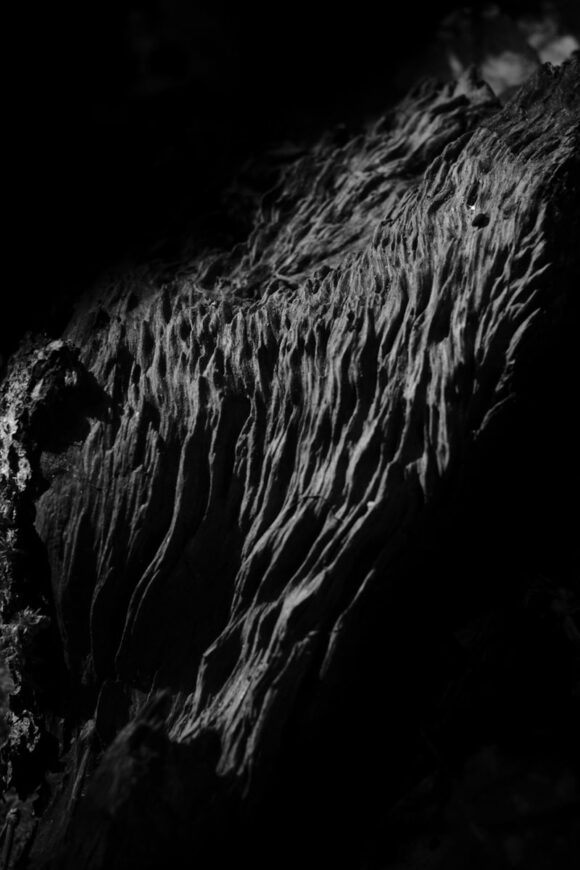

Qu’est-ce qui t’a décidé, finalement ?
Une nuit de décembre, en 2014, elle s’est suicidée. La musique m’est devenue insupportable, le langage me paraissait vain et creux… La photo m’est apparue comme salvatrice. Je n’avais plus rien à perdre, en quelque sorte. Je pouvais m’immerger pendant une heure à genoux dans le froid à observer un insecte de 3 mm qui semblait parader pour moi ! J’avais besoin du silence que le médium me procurait. Je photographiais en écoutant, parfois même en fermant les yeux…
Comment définirais-tu ton approche ?
Elle est à la fois instinctive et contemplative. Parfois compulsive, mais ça va mieux. Je sors souvent marcher avec mon boîtier, sans l’intention de photographier. Parfois, je m’interdis de faire une image parce que j’ai déjà capturé mille fois le sujet, je poursuis alors mon chemin, mais souvent, cela m’obsède, je cède et j’y retourne. C’est une sorte d’appel. Lorsque je suis pleinement disposé, quelque chose coïncide entre mon environnement et mon état intérieur – une effervescence, un paradis qui peut durer 20 à 30 minutes… Et qui donne d’ailleurs rarement des images à garder !
Comment est né le livre Reliqua desiderantur ?
J’ai trouvé le titre il y a une quinzaine d’années. Je lisais alors le Traité de réforme de l’entendement de Spinoza. Cet ouvrage se termine par ces mots en latin : reliqua desiderantur, le reste manque. Je trouvais cela beau et mystérieux. Je suis allé à la rencontre d’un poète, théoricien du langage et traducteur de la Bible, Henri Meschonnic, dont j’avais dévoré l’ouvrage Spinoza, poème de la pensée. Je me suis risqué à l’aborder pour lui témoigner mon admiration. Naïvement, je lui ai aussi demandé ce qu’avait bien pu vouloir dire Spinoza avec cette formule. Il m’a répondu : « Mais ce n’est pas lui qui l’a écrit, c’est une formule de l’éditeur qui signifie que l’ouvrage est inachevé ! », avant de me rassurer : « Allons, ne faites pas cette tête, vous avez fait de quelque chose de fini quelque chose d’infini ». J’ai alors su qu’un jour je ferais quelque chose de ces mots.

De quoi est-il composé ?
Les images ont été réalisées entre 2017 et 2021, dans plusieurs endroits, principalement autour de chez moi ou lors de voyages. Ce n’est pas vraiment le lieu qui compte, mais plutôt le non-lieu. Après m’être intéressé à tous les domaines du médium, j’ai compris que ce qui me portait, c’était le travail d’auteur. En 2019, je me suis inscrit au Milk, une master class dirigée par Sabrina Biancuzzi et Ljubisa Danilovic. C’était une année d’immersion totale, un travail énorme sur l’éditing. Le parrain de cette session était Julien Magre – une rencontre décisive pour ce livre. Mais pour le finir, il aura fallu encore d’autres éditings, avec Fannie Escoulen, notamment, produire, se perdre, se répéter, essayer, se décourager, tenir…
Ton livre s’articule à la manière d’une enquête, dans laquelle se croisent images et textes. Pourquoi avoir opté pour cette narration immersive ?
L’immersion est un terme juste pour décrire ce que je vis de manière générale. Je voulais au départ m’inspirer des motets (une composition musicale apparue au 13e siècle d’une ou plusieurs voix, avec ou sans accompagnement musical, NDLR). J’avais également enregistré, pour un essai de film photo, les extraits du rapport de police que j’ai reçu à la mort de ma sœur. Certaines phrases – il m’aura fallu sept ans pour pouvoir le relire avec distance – m’ont littéralement subjugué. J’ai ressenti une sidération, comme devant ce qui me fait photographier.
Lorsque j’ai lu l’extrait « quittons les lieux à fin de rédaction du présent », il ne s’agissait plus d’un rapport sordide, mais d’un poème ou d’un aphorisme. Sans cette transformation, je n’aurais jamais écrit ce livre. J’ai pris cette phrase à la fois littéralement et philosophiquement. C’était ma mission : rédiger le présent en quittant les lieux. Une utopie pour devenir sujet et non assujetti. J’ai alors décidé de faire jouer ces phrases et ces images, comme une élucidation et comme un obscurcissement.
Dirais-tu que ce travail a été thérapeutique ?
S’il s’agit d’une thérapie, je crois qu’elle a complètement échoué. Bien sûr, la pratique obsessionnelle de la photographie m’a aidé à traverser le deuil dans les premières années. Mais il ne s’agit pas ici d’un travail de deuil. Un travail d’œil, et encore… Devant ces vies inachevées-achevées, il y a même, je crois, un refus ou une incapacité du deuil.


Tu nous emportes dans un univers monochrome, solitaire, mélancolique… Quelles émotions souhaitais-tu représenter ?
Sans doute suis-je moi-même solitaire et mélancolique. Voire monochrome, il faut que j’y réfléchisse… Le noir et blanc est plutôt un synonyme d’interpénétration, de fusion, de nuances entre les attributs d’une même substance.
Je n’ai pas du tout d’intention émotionnelle, à vrai dire. Je fais ce qui me touche et m’intrigue, ce que je ne comprends pas. Peut-être ai-je tout de même envie de faire ressentir un certain suspense, une certaine angoisse… Et un peu d’humour, ou de l’ironie noire. Mais il y a surtout, dans mon travail, une volonté de partager l’impartageable. De montrer ce qui se passe dans une âme, un corps, de rencontrer et d’aimer le cœur de certain·es lecteur·ices… Rien que ça !
Pourquoi avoir fait le choix d’un petit format ?
C’était un faux choix, mais assumé. Arnaud Bizalion, l’éditeur m’a proposé ce format, car il faisait partie de sa collection Notes. Si j’ai d’abord hésité, cela m’a ensuite libéré.
Celui-ci demande bien sûr un effort pour se rapprocher, scruter, et éventuellement se laisser happer. Un effet « trou noir » qui agit de très loin. Et de plus, j’aime, tout simplement, le côté facilement échangeable de l’objet.
Quelles thématiques explores-tu, à travers cette enquête imagée ?
En filigrane, il y a ce qui m’a toujours fasciné : le questionnement sur le langage, la traduction. C’est un petit poème en prose visuelle. Le rapport au soi-disant réel, également, qui est une fiction comme les autres. « L’ile-réelle », comme je l’appelle.
On y trouve aussi une tentative de voyage vers l’autre monde et l’autre soi. Mais on reste dans les limbes. Ce livre raconte une certaine incapacité, un échec, une impossibilité à accéder à la vie, tout en ne renonçant pas à devenir sujet, en montrant justement cette incapacité.
Sans oublier l’oubli ! Ce que je vois me dit : « regarde-moi, tu as oublié quelque chose d’essentiel et tu ne sauras jamais quoi ».
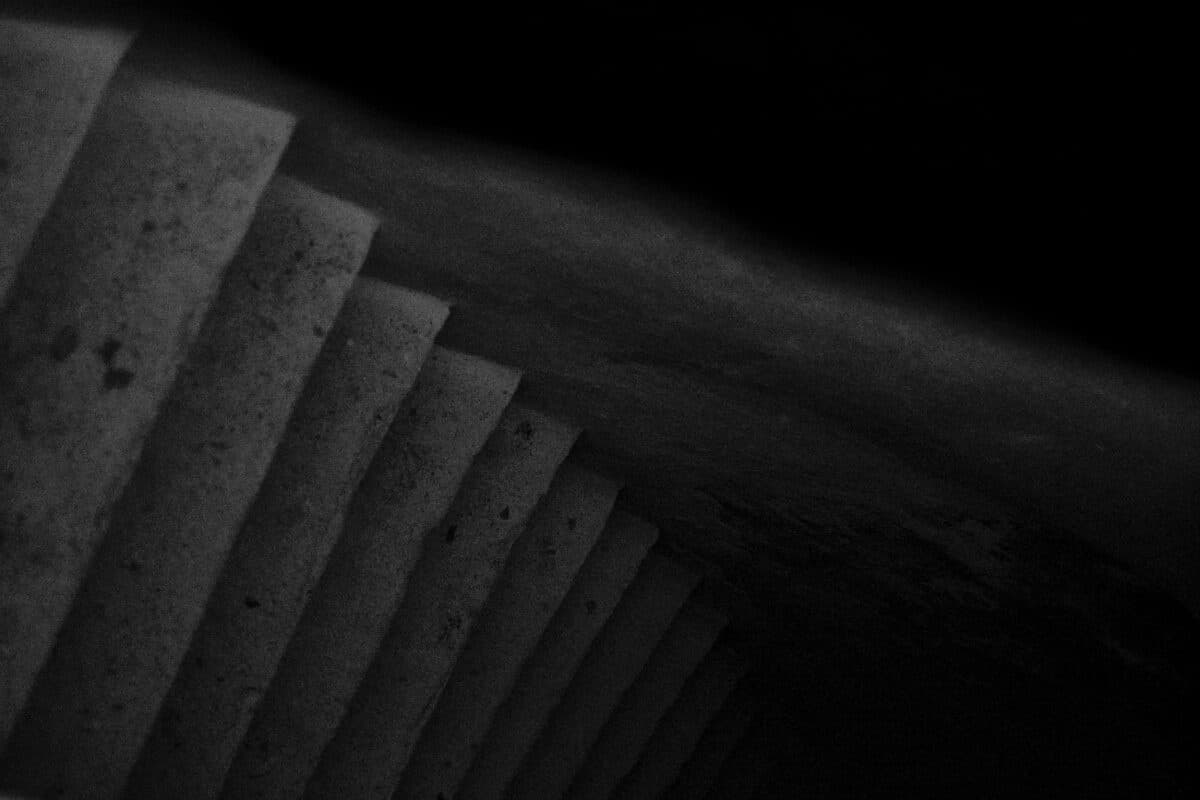
Des influences qui t’ont marqué ?
Je ne suis qu’influences. La littérature et la musique – vous l’aurez compris – les rencontres, les avis… Je suis sans cesse en réaction face à ce(ux) qui m’entoure(nt). Les influences photographiques, elles, sont venues après coup. Je laisse infuser sans trop contrôler. J’absorbe, je mimétise inconsciemment, parfois je cite délibérément, je réponds. Mais ce sont les écrits sur les photographes qui me passionnent le plus : Arnaud Claass et Gilles Mora sur Walker Evans sont les premiers noms qui me viennent en tête.
Un dernier mot, en guise de conclusion ?
Aucun rapport… Mais ce livre aurait pu s’appeler Aucun rapport, parce qu’il s’agit d’un rapport de police retranscrit avec une certaine police… Et surtout pour la première phrase que Romain Gary a écrite dans sa lettre d’adieu avant de se suicider : « Aucun rapport avec Jean Seberg. Les fervents du cœur brisé sont priés de s’adresser ailleurs ».
Ce livre n’a aucun rapport avec ma sœur, car le sujet est ailleurs, comme la vérité. Ma sœur ne peut être réduite à sa mort ni à ma relation avec elle. Mais à la fois, il est complètement en rapport avec elle, car sans elle, et j’oserais même dire sans son sacrifice, il n’y aurait pas eu ce désir. Ce reste qui ne dit pas son reste.
Reliqua desiderantur, Éditions Arnaud Bizalion, 18€, 84 p.

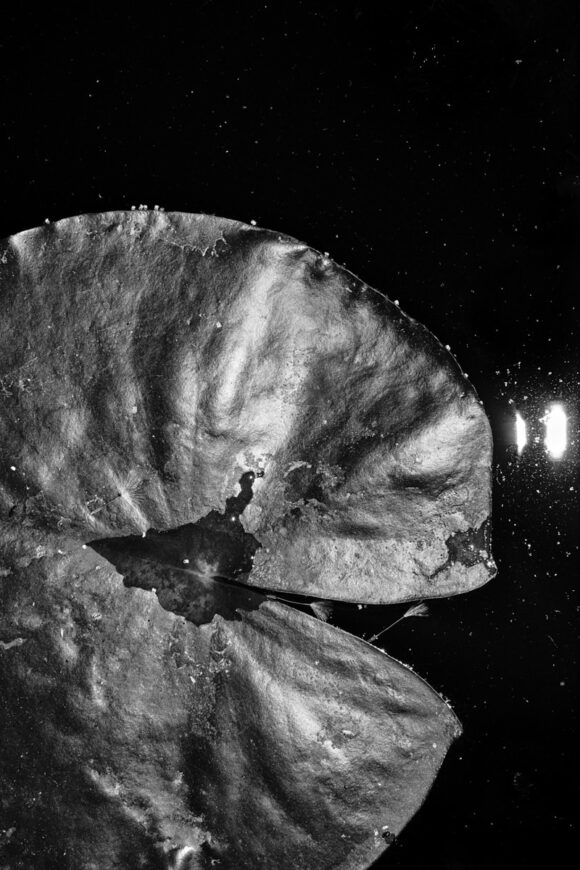


© Benoît Méjean