
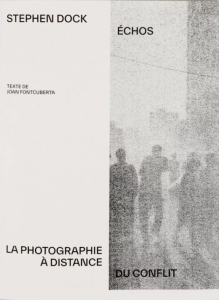
2024
Texte de Joan Fontcuberta
21 x 28 cm
120 pages
39€
Dans sa vingtaine, Stephen Dock s’est confronté aux tensions qui animent Syrie, Jordanie, Irak, Liban, et bien d’autres coins du globe. Échos, une exposition présentée à l’occasion des Rencontres d’Arles 2024, ainsi qu’un livre paru en juin dernier chez delpire & co, donne à voir non pas l’un de ses multiples reportages sur les conflits géopolitiques, mais un travail de fond sur la représentation de la guerre elle-même.
« Ma première parution était une image publiée à l’occasion de la demande d’adhésion de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies dans Le Monde, en 2011. Je me suis rendu sur des terrains risqués au Moyen-Orient et en Afrique, ai couvert des catastrophes telles que le séisme de 2015 au Népal ou la crise Ebola au Libéria. Ensuite, ma découverte de l’Irlande du Nord et de son histoire a constitué une véritable rupture : ma photographie s’est transformée, et j’ai compris qu’il fallait chercher ailleurs que du côté des évidences », résume Stephen Dock en évoquant ses débuts dans l’univers éprouvant du photojournalisme. Si le jeune homme s’attaque d’abord aux conflits à chaud, il s’intéresse, dans un deuxième temps, aux espaces où la violence n’est pas tout à fait flagrante. Presque naturellement, il s’oriente alors déjà vers une approche plus artistique, moins attachée aux faits. Il intègre plus tard l’Agence VU’, multiplie les publications dans la presse française et internationale, expose en festivals et se fait remarquer lors du Prix Leica Oscar Barnack 2018. Aujourd’hui, plus de dix ans après ses premiers travaux, Stephen Dock est fatigué de démontrer, et ambitionne désormais de déconstruire.
« Cette première séquence de ma vie, dans laquelle ma pratique était empirique et instinctive, est la base de mon écriture. Mais j’agis maintenant à l’inverse. J’articule mes projets, j’ai une vision de la forme finale et un chemin qui m’y conduit. Je ne saisis plus l’événement, ni n’emmagasine d’images compulsivement », déclare-t-il. Sélectionnant méticuleusement certaines photographies issu·es de son très large corpus de productions, Stephen Dock choisit volontairement de les réviser, à travers la retouche, le recadrage, le dépouillement. Mettant la focale ailleurs, obscurcissant certains aspects, jouant sur le support matériel. En retravaillant des visions d’un temps révolu, il leur redonne une nouvelle existence, dans une tentative de rejoindre une approche plastique et approfondie. En réalité, l’auteur d’Échos a eu le désir de libérer ces clichés de la contrainte de la temporalité, puisque condamnés, dans une perspective photojournalistique, à périmer presque instantanément. L’actualité, les faits, les vident de leur substance. « Je voulais souligner la durée de vie extrêmement limitée de ces photos que l’on peut capturer dans ces situations, explique le Mulhousien. Ce projet ne pouvait fonctionner qu’avec une réelle distance entre la prise de vue et l’exposition – soit plus d‘une décennie. » Dans l’ouvrage, les légendes des images ont disparu – celle ou celui qui souhaite en connaître l’origine peut néanmoins se référer aux dernières pages – de sorte qu’elles ne fonctionnent plus que comme des résonances lointaines.



Un projet post-photographique
« Plus jeune, j’étais fasciné par la figure du reporter de guerre, se souvient-il. Je voulais me confronter à ces territoires, à cette réalité. Ce n’était pas seulement une envie, j’en avais le besoin. C’est cette nécessité d’aller vers ces endroits qui m’a poussé dans cette voie. Je ne cherchais pas le journalisme, mais bien le 8e art. » En 2024, c’est pourtant même au-delà de ce dernier que regarde le trentenaire autodidacte. Son présent travail s’inscrit dans la post-photographie, c’est-à-dire la réflexion critique vis-à-vis des images déjà produites, et l’interrogation de l’évidence. « Pour moi, le point ultime du processus était d’abandonner les miennes, pour finir par m’approprier une autre ressource, celles disponibles pour tous·tes sur Internet, révèle-t-il. Un geste qui résume mes doutes quant à l’utilité de cette archive, et questionne mon rôle d’auteur. » Développés à la chambre, les photos de sa série Capture permettent à leur créateur de renouer avec la matière du médium, ainsi que les êtres et les objets capturés. Réplique se concentre sur le papier et sur la notion de reproductibilité. « J’ai photocopié à plusieurs reprises mes clichés qui représentaient des scènes assez caractéristiques, que l’on a déjà vues mille fois. C’était une façon de les détruire, de les réduire à leur strict minimum. J’appelle cela les “laver”. Il faut une certaine distance pour les rendre lisible, au sens propre comme au figuré », explique-t-il. Ce sont ces différents projets, entre autres, que rassemble Échos, réalisé en collaboration avec Emmanuelle Kouchner – directrice des éditions delpire & co – la commissaire de l’exposition Audrey Hoareau, l’atelier Pentagon et le photographe plasticien Joan Fontcuberta.


L’image est devenue une arme de guerre
Depuis la publication des premiers travaux de Stephen Dock, la manière de produire et de diffuser les images de guerre a drastiquement changé. En cause principale, la technologie, les drones et satellites captant désormais tout ce qu’il y a à enregistrer. « Les gouvernements ont compris le rôle de la photo. Il y a donc un contrôle plus accru, une rétention parfois – on le voit bien avec le cas de Gaza aujourd’hui. Elle est une information, une arme », constate-t-il. Pour autant, a-t-on une vision plus juste des affrontements ? La surabondance visuelle ne nous assommerait-elle pas au contraire jusqu’à générer un effet de banalisation, voire de désensibilisation aux récits de la violence ? Face à cette observation amère, il s’agit de concéder que la photo de conflit n’a jamais pu être en phase avec notre monde actuel. « De tous temps, la retouche, la falsification des clichés de guerre s’est pratiquée, rappelle-t-il. C’est ce qui rend épineux la question et le rôle de ceux qui produisent l’image. Elle sera toujours un parti pris. On peut tenter de parler autrement de ses troubles, de façon plus visuelle, plus sensible, moins factuelle. » Complexifier la photographie, pour la rendre plus honnête, c’est précisément la vocation de cet ouvrage singulier et remarqué.
Une obstination à observer ce qui ne se voit pas
À l’inverse de l’œuvre que le photographe développait jusque-là, Échos part d’un point global et prédéfini, et trouve sa puissance dans sa capacité à le poursuivre avec radicalité, justesse et précision, tout au long du projet. « Le 8e art ne supporte pas l’à-peu-près », soutient Stephen Dock. Dans un texte intitulé « Du récit de guerre à la guerre du récit », Joan Fontcuberta écrit à propos de la proposition de l’auteur qu’elle est « comparable à la démarche des astrophysicien·nes lorsqu’iels s’obstinent à observer des trous noirs qui ne peuvent pourtant pas se voir ». Ces trous noirs qui ont fait l’obsession du jeune homme, naissent peut-être justement de son insatisfaction perpétuelle, de son incapacité à trouver la paix. « En épiant le monde, insaisissable, en proie à tant d’ambiguïté, on fait face à une violence qui peut être ou bien exprimée, ou tue. Parfois, elle me fascine et devient l’objet de mon entêtement. J’ai le sentiment d’être sans cesse en quête, et de rarement atteindre », confie l’artiste.









